Marcos me reçoit dans la pièce principale de son appartement. Des rayonnages de DVD, de livres et de revues tapissent les murs, une table disparaît sous une montagne de documents. Des jouets de construction laissés au sol par ses trois jeunes garçons rappellent que le lieu est à la fois un espace familial et un espace de travail. Pour Marcos, le cinéma se décline sur tous les tons, sujet d’étude et de travail, pratique amateur et professionnelle, plaisir personnel et objet de partage, partage de connaissance et d’émotion …
Se présenter en quelques mots…
Je suis avant tout cinéphile. J’exerce plusieurs métiers liés au cinéma. Je suis à la fois critique et programmateur. Je fais de la formation auprès de divers publics. J’essaie aussi de réaliser. Pour résumer, tout tourne autour des films : en voir, en montrer, en parler et peut-être en faire.
Qu’est-ce qui a été le plus formateur pour toi dans ton enfance ?
Enfant, j’étais très casanier, pas très sportif. Lorsque j’avais 13 ans, ma mère m’a inscrit à un club photo. Ça été décisif pour moi. Grâce à la photo, je suis sorti de chez moi, ça m’a donné une bonne raison d’aller à la découverte du monde qui m’entourait et à la rencontre des autres !
Une image qui t’accompagne …
Il y a un film que j’ai découvert ado et que je revois souvent, que je connais presque par coeur : «Partie de campagne» de Jean Renoir.
C’est l’un des films les plus sensuels qui soient et en même temps l’un des plus mélancoliques. Il reste mon film préféré.
Quel est ton premier souvenir de cinéma ?
C’était en Espagne, dans une très grande salle. Je devais avoir trois ans. Je me souviens d’un gorille géant détruisant des hélicoptères puis faisant un signe aux spectateurs pour montrer qu’il était le plus fort. J’étais effrayé et je ne comprenais pas pourquoi les gens autour de moi riaient. Je crois avoir retrouvé depuis de quel film il s’agissait : « APE », une parodie de King-Kong réalisé par Paul Leder.
Tu as eu aussi très tôt, dès l’adolescence, le désir de faire des films, peux-tu nous parler de tes premières expériences derrière la caméra ?
A 15 ans je me suis acheté une caméra super 8. Je faisais des petites fictions avec des copains. Je me souviens aussi d’un film sur mon chat, dans lequel j’avais imaginé l’un de ses rêves. J’avais mis un bas sur l’objectif de la caméra pour rendre l’image floue puis j’ai filmé au ralenti une multitude de fenêtres et de portes qui se fermaient…
Je continue à filmer régulièrement en Super 8, ma famille et mes amis essentiellement. C’est un format amateur assez simple à utiliser tout en restant du cinéma, avec une image à projeter. Mon goût pour ce format est aussi lié au fait que mes grands-parents filmaient beaucoup en Super 8 (la famille, leurs voyages). Quand, j’étais enfant nous regardions leurs films chaque Noël. L’image Super 8 a une texture unique, je ne connais rien de plus beau pour garder des souvenirs.
Après ton bac tu t’inscris au département Cinéma de Paris 8 avec Jean Narboni plutôt qu’à La Fémis, le «dire» l’emporte-t-il alors sur le «faire» ?
Non, je venais d’avoir mon bac à Angers. Pour intégrer la Fémis, il faut un niveau bac + 2. J’ai donc décidé de faire un DEUG avant. La fac de Paris 8 était facile d’accès pour un étudiant de province. Il y avait encore un esprit soixante-huitard qui avait ses inconvénients mais qui offrait surtout une formidable liberté, de pensée, de parole. J’ai fait des rencontres marquantes. Jean Narboni, qui avait notamment été rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma, représentait pour moi une figure importante de l’histoire de la critique. J’ai beaucoup apprécié son rapport aux films. Il ne faisait pas de cours magistraux, il nous montrait des films et provoquait l’échange. Il se mettait en retrait pour faire participer les étudiants, sans se placer au-dessus d’eux. J’étais tellement bien à Paris 8 que je n’ai finalement jamais passé le concours de la Fémis. D’ailleurs, Paris 8 était une fac où il y avait pas mal de pratique. Par exemple, j’avais un cours de montage (en 16 mm) avec Cécile Decugis qui a travaillé avec Godard, Truffaut, Rohmer…
C’est aussi à Paris 8 que j’ai réalisé mon premier court métrage en 16 mm. J’avais eu droit à deux bobines de 30 mètres (6 min environ). J’ai filmé un taxidermiste, puis j’ai ajouté un commentaire en voix off. C’est un film très inspiré du « Sang des bêtes » de Georges Franju, qui avait été un choc pour moi.
Un an plus tard, toujours à Paris 8, j’ai réalisé « La ville des chiens » sur la vieille ville de Goussainville, qui était devenu un véritable village fantôme depuis la construction de l’aéroport de Roissy. Bref, il était possible de réaliser des films dans cette université. Le « voir », le « dire » et le « faire » allaient ensemble.
Que t’inspire la vieille idée du critique vu comme un cinéaste frustré ?
Il y en a sûrement ! Mais c’est une vision très négative. Moi, je crois plus à l’idée de Jean Douchet que la critique est l’art d’aimer.
On écrit pour des raisons contraires à la frustration, on écrit pour formuler des sensations, des idées sur les films. Il faut rappeler que quand on écrit des critiques, on est rarement payé. Les critiques gagnent leur vie autrement. C’est par passion qu’on fait ça, et non par ressentiment ! Par ailleurs, même si ce n’est pas mon cas, je ne suis pas choqué que des critiques ne s’intéressent pas du tout à la pratique. On peut très bien parler d’un film sans savoir en faire.
J’ai été touché que le comité de rédaction de la revue Trafic me demande d’intégrer la revue. Cette revue mythique a été fondée notamment par Serge Daney il y a une vingtaine d’année. Cela correspond à peu près à mon arrivée à Paris. Je me revois très bien achetant le numéro 1. Le rythme de parution, trimestriel, permet un recul, une liberté par rapport à ce qu’on appelle « l’actualité du cinéma », imposée par le rythme des sorties en salles. François Truffaut a défini la politique des auteurs de films, Serge Daney avait, quant à lui, l’ambition de proclamer la politique des auteurs de textes sur le cinéma. Dans Trafic, c’est chaque auteur qui définit ce qui constitue pour lui l’actualité cinématographique, son actualité de spectateur. Ça peut être un film qui vient de sortir aussi bien qu’un film muet, une installation d’art contemporain autant qu’une question esthétique qui traverse toute l’histoire du cinéma.
Tu participes à des actions liées à l’éducation à l’image notamment dans le cadre du dispositif «école et cinéma». Quels sont pour toi les fondements d’une culture cinématographique ?
Ce que j’essaie de faire passer aux enfants mais aussi aux adultes, c’est de se sentir très libre par rapport aux films, sans aucune barrière culturelle. Ce n’est pas si facile d’être totalement soi-même devant un film, en mettant de côté tout ce que l’on en sait déjà, en ne se laissant pas écraser par tout le poids culturel dont il est chargé. Par exemple, il est toujours très difficile de voir pour la première fois un film qui est considéré comme un « grand classique », parce que notre regard est déjà conditionné par sa réputation. C’est d’autant plus vrai dans un cadre scolaire. Alors, pour dépasser ça, il faut permettre aux élèves d’exprimer le plus librement possible ce qu’ils ont ressenti, en leur disant que nous n’attendons pas des bonnes ou des mauvaises réponses de leur part, ni même qu’ils aiment ce qu’on leur montre, mais seulement qu’ils sachent exprimer leur émotion ou leur rejet. Il faut donc éviter les grilles de lecture préétablies, les idées arrêtées. Je pense à cette phrase de Truffaut : « Il faudrait considérer les films comme des êtres vivants ». Pour moi, à chaque film c’est tout le cinéma qui se rejoue. Il n’y a pas une conception du cinéma qui est plus légitime qu’une autre. Je peux aimer avec la même force des films très différents dans leur vision du cinéma, un film néo-réaliste italien autant qu’un film fantastique hollywoodien, un documentaire de Flaherty autant qu’un dessin-animé de Tex Avery. C’est en cela que le cinéma est un art : chaque artiste le réinvente pour lui-même. De même, en chaque spectateur chaque film résonne d’une façon différente.
Tu as un lien très fort avec la maison d’édition «Yellow Now» en tant qu’auteur mais aussi en tant que directeur de la collection «Côtés films». Qu’est-ce qui t’anime dans cette fonction ?
C’est un travail assez beau que d’aider les auteurs à accoucher d’un livre. Tout commence par mon propre plaisir de lecteur. Il y a quelques textes sur le cinéma qui m’ont autant marqué que des films. Ecrire sur le cinéma peut être un vrai exercice de création. Au départ de la collection, on était deux directeurs, je travaillais avec Fabrice Revault qui a été un de mes profs à Paris 8. L’idée était de proposer à des auteurs que l’on aimait d’écrire sur des films qu’ils aimaient, sans contrainte, sans cahier des charges. Dans cette collection, j’ai édité des auteurs qui m’avaient marqué quand j’étais étudiant. C’est assez émouvant de continuer de cette façon le « passage de relais ». Je pense à Narboni, à Revault mais aussi à Prosper Hillairet qui était un prof passionné et passionnant qui m’avait fait découvrir le cinéma expérimental, le cinéma underground américain.
Tu es aussi depuis quelques années programmateur à l’auditorium du Musée d’Orsay. En lien avec les expositions du musée, tu réalises un travail important de défricheur du cinéma des origines. Quelle part de contraintes et de liberté rencontres-tu dans ce travail ?
Ma programmation doit avoir un lien, soit avec les expositions du musée, soit avec la période de référence (1848-1914). Je peux travailler sur une thématique (Rêver d’Edgar Allan Poe), sur un cinéaste (Alice Guy), sur une maison de production (Dans la nuit de la Hammer)…
Par exemple, en lien avec l’exposition « L’ange du bizarre », on a décidé de proposer un sujet de cycle qui puisse exister à part entière plutôt qu’une programmation uniquement illustrative du thème de l’exposition. D’autant que le cinéma y est déjà très présent à travers des projections d’extraits de films, il ne fallait donc pas être redondant. On a donc cherché à mettre en valeur une cinématographie assez rare, méconnue du grand public et même de certains cinéphiles, en présentant des films de trois grands auteurs scandinaves : Sjöström, Christensen et Stiller. Le public était présent aux séances, on est content d’avoir donné une visibilité à ces films, dont certains sont parmi les plus beaux du cinéma muet. C’est très satisfaisant de montrer des films rares, et que des gens viennent les voir et les aiment. Ça donne le sentiment de participer un tout petit peu à l’histoire du cinéma…
Une dernière question ! Dans le texte de présentation, au dos de la couverture de ton livre sur Tourneur, on apprend que tu as fait une conférence sur Boby Lapointe à des universitaires anglais…
C’est vrai, j’ai réellement fait une conférence sur Boby Lapointe à Manchester ! C’était pour un colloque consacré à la chanson française. J’ai répondu à une annonce en proposant une contribution sur Boby Lapointe et j’ai été retenu. Même si j’avais face à moi un public francophone, l’explication de certains jeux de mots à des anglais était un vrai défi ! On ne peut pas imaginer un chanteur plus intraduisible que Boby Lapointe.
J’aime bien la chanson même si j’ai un rapport d’amateur avec cet art. Je me suis beaucoup amusé à réaliser des petits clips en Super 8 pour le chanteur Athanase Granson et le groupe Like billy-ho .





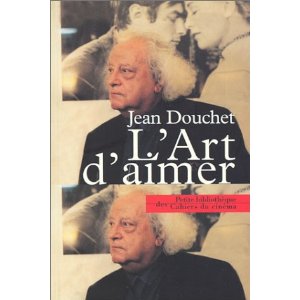
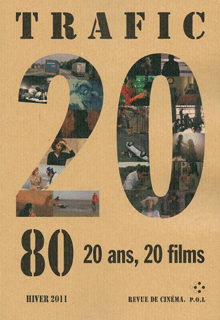

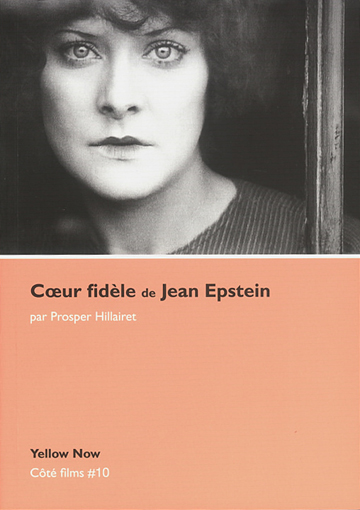

bonjour..
deja merci de l’ensemble de votre ‘oeuvre’ et des partages que vos pages nous offrent.
il y a parfois quelques (petites) bizarreries..
par exemple ds la photo boby et azna…
pourquoi « serge »! oui pourquoi??
..’peut etre avez vous une raison… dites nous…
ok le cinema, les immigrés si doutés (et bosseurs!!)
alors ce serait un cousin armenien de l’italien /beau serge?
http://lafilledecorinthe.com/wordpress/2013/06/marcos-uzal-critique-de-cinema
casque d’or coming back?
certes son ‘vrai’ nom est complexe…
. . (shahnourh varinag aznavourian ;-))
mais il faut bcp remuer les lettres pour arriver à serge?
bien à vous!
Juste une erreur ! Corrigée avec beaucoup de retard mais une fois publié je relis très peu les articles. Merci